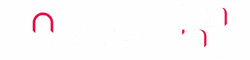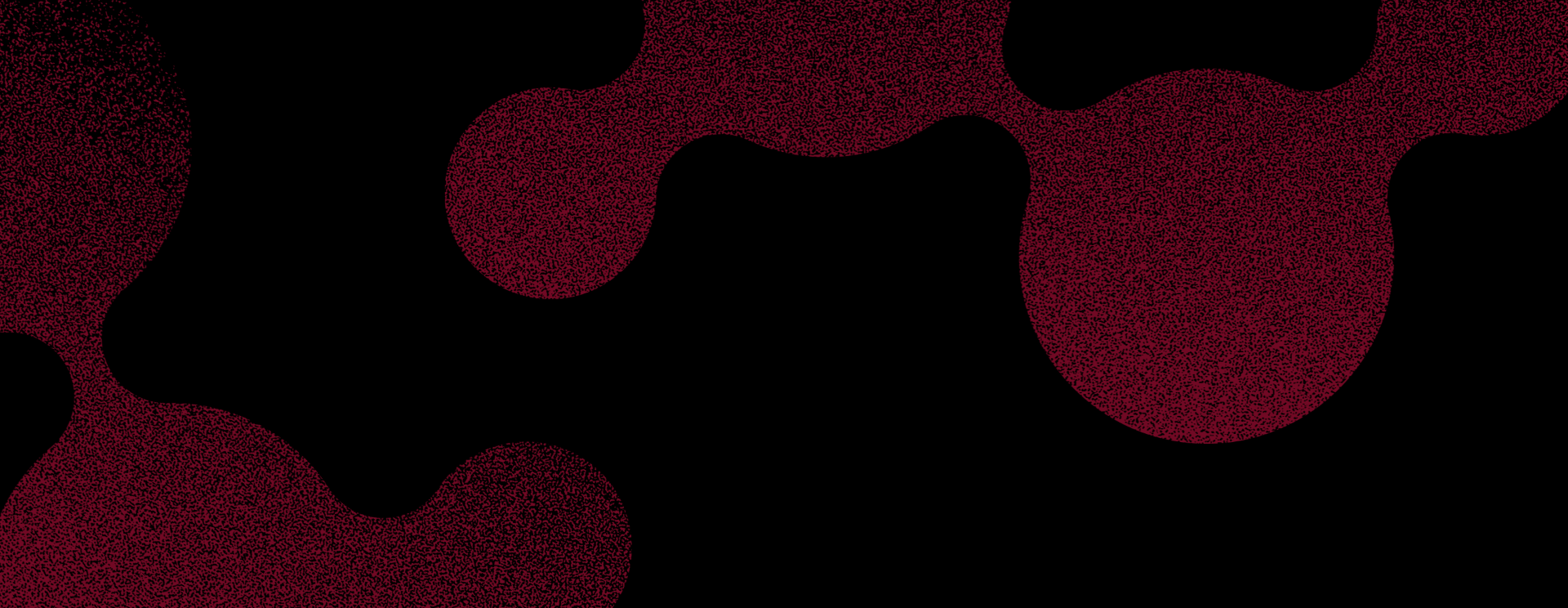Santé, Vidéo : Magalie Lecourtois – la génétique et la maladie d’alzheimer : les cellules souches à la rescousse ?
Publié le – Mis à jour le
Conférencière : Magalie Lecourtois, Directrice-Adjointe, École Doctorale Normande de Biologie Intégrative, Santé, Environnement (ED-NBISE 497), Inserm, UMR 1245, Cancer and Brain Genomics (CBG).
Les avancées récentes dans l’analyse du génome humain ont permis l’identification de nombreux facteurs génétiques augmentant le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Nous verrons comment les cellules souches nous permettent d’élucider les mécanismes biologiques par lesquels ces facteurs génétiques contribuent au développement de la maladie, un enjeu de recherche majeur pour mieux comprendre la maladie et ainsi mieux la traiter.

Dans le cadre de la conférence intitulée “La génétique et la maladie d’Alzheimer : les cellules souches à la rescousse ?”, Magalie Lecourtois, chercheuse au CNRS, explore le rôle potentiel des cellules souches dans la compréhension des mécanismes biologiques liés à la maladie d’Alzheimer. Elle commence par rappeler quelques faits sur cette maladie, la plus courante des démences, affectant plus d’un million de personnes en France. La maladie d’Alzheimer, caractérisée principalement par des troubles de la mémoire et autres déficits cognitifs, est accentuée par le vieillissement de la population.
Elle aborde ensuite l’utilisation des cellules souches pluripotentes induites (iPS) pour étudier les facteurs génétiques de risque associés à la maladie. Ces cellules peuvent être reprogrammées à partir de cellules adultes pour produire différents types de cellules, y compris des neurones, ce qui permet de modéliser la maladie et d’étudier les impacts génétiques sur les cellules nerveuses.
Magalie Lecourtois présente également des résultats de recherche montrant comment les anomalies génétiques augmentent le risque de neurodégénérescence. En particulier, elle discute des protéines tau et Aβ, qui forment des agrégats toxiques dans les cerveaux atteints. La recherche génomique a identifié plusieurs régions chromosomiques influençant le risque de développer la maladie.
Enfin, elle met en lumière l’importance des avancées technologiques, comme le CRISPR-Cas9 pour l’édition génétique, qui permettent de modifier les cellules iPS avec des variants génétiques spécifiques. Cela aide à comprendre comment les variations génétiques influencent le développement de la maladie et ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques potentielles. Cette approche n’est pas seulement académique ; elle a des implications concrètes pour le diagnostic, le conseil génétique, et potentiellement pour le développement de traitements préventifs.
La conférence de Magalie Lecourtois se conclut en ayant illustré l’intersection entre la génétique, la technologie des cellules souches, et la lutte contre la maladie d’Alzheimer, soulignant l’importance d’une recherche innovante dans la compréhension et le traitement de cette maladie complexe.